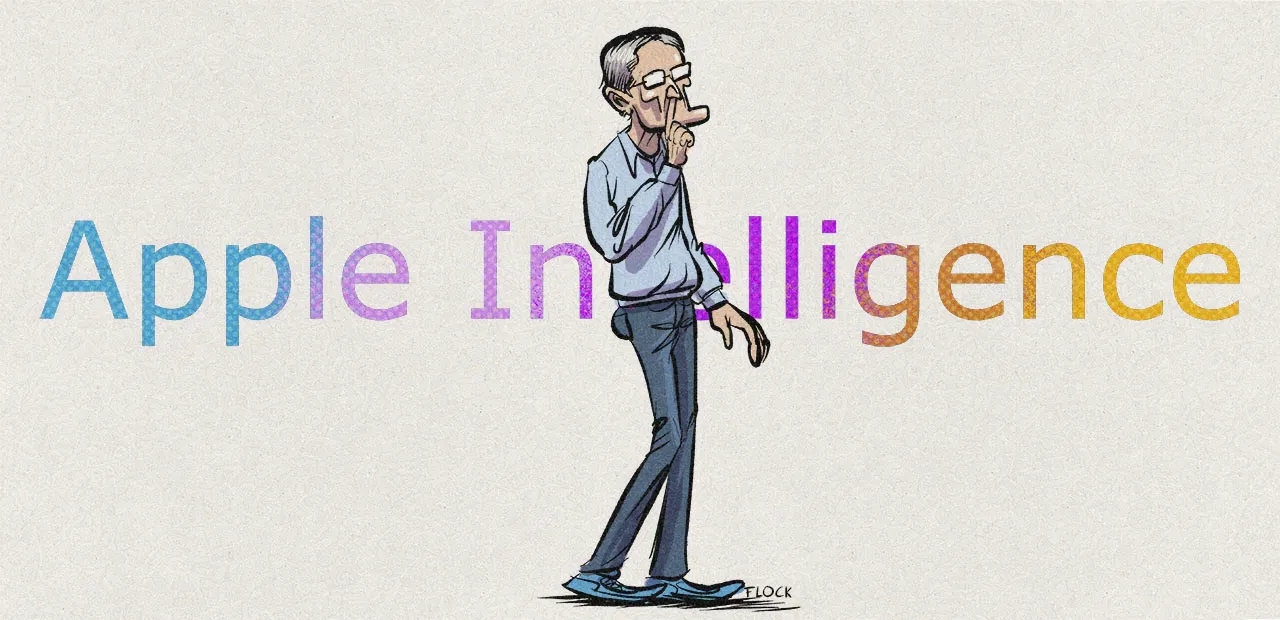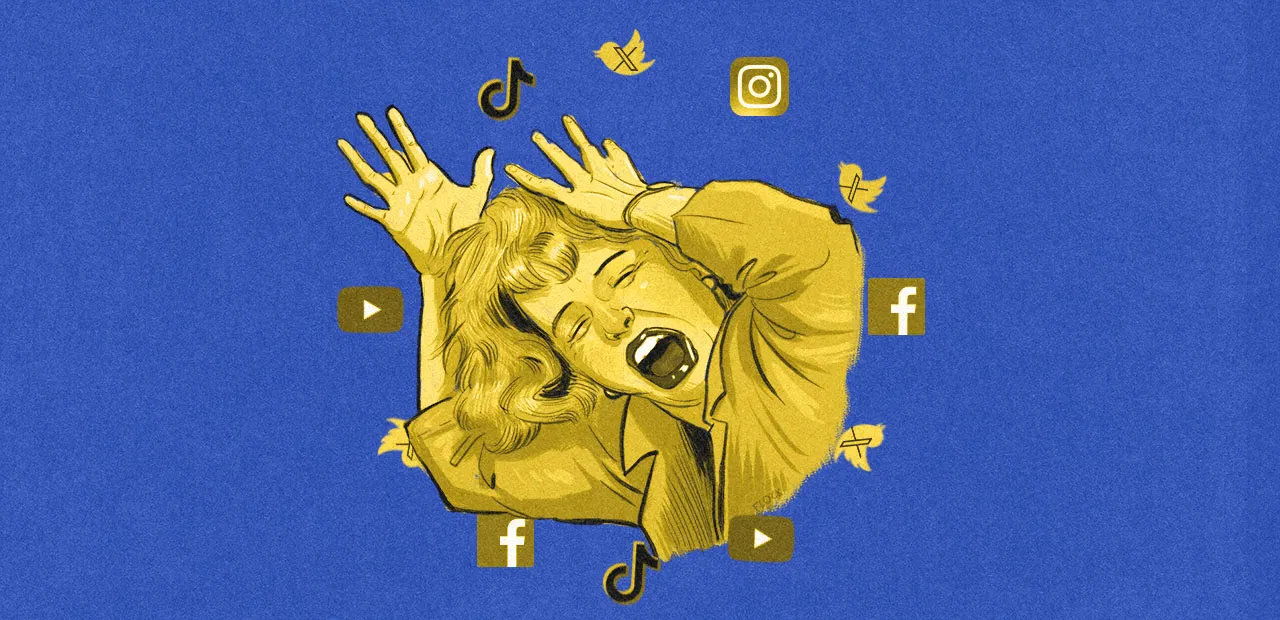Disponible, le Fairphone 6 se modernise et vise une grande durabilité
Leçon n°6

Le nouveau Fairphone vient d’être révélé. Disponible dès maintenant une version unique vendue 599 euros, le nouveau smartphone se modernise allègrement. Plus puissant et faisant un gros effort sur l’écran, le Fairphone 6 se veut particulièrement durable et obtient au passage la meilleure note sur la toute nouvelle étiquette énergie.
Le nouveau Fairphone ne change pas la recette qui a fait son succès. On reste sur une conception très modulaire (qui n’a pas toujours que des avantages), une construction respectueuse de l’environnement et une durabilité qui surpasse même en théorie les meilleures annonces dans ce domaine, notamment chez Google et Samsung.
Une base matérielle plus moderne
On commence par l’écran, légèrement plus petit que celui du Fairphone 5, passant de 6,46 à 6,31 pouces. En revanche, sa technologie est nettement plus récente. Il s’agit d’une dalle OLED LPTO dont la fréquence peut osciller entre 10 et 120 Hz selon les besoins. Un rafraîchissement variable qui aide l’autonomie du téléphone. Sa définition est de 1 116 x 2 484 pixels, soit une densité de 431 ppp (pixels par pouce). Elle est recouverte d’une couche de protection Glorilla Glass 7i.
Au cœur de l’appareil, on trouve un Snapdragon 7 s Gen 3. Une solide puce de milieu de gamme (4x Cortex-A720 et 4x Cortex-A520) épaulée par 8 Go de mémoire (LPDDR5). Côté stockage, on a droit à 256 Go, un port microSD permettant d’ajouter jusqu’à 2 To. La connectivité est assurée par du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.4 et du NFC. On retrouve bien sûr le classique port USB-C, mais pas de prise jack 3,5 mm.
Parmi les autres prestations techniques, signalons un capteur d’empreintes digitales placé dans le bouton d’alimentation, sur la tranche droite. La partie photo est alimentée par trois capteurs : un grand-angle principal de 50 mégapixels (Sony Lytia 700C) avec ouverture f/1,88, un ultra grand-angle de 13 mégapixels avec ouverture f/2,2 et une caméra frontale de 32 mégapixels (Samsung KD1 32 MP).
Côté batterie, le Fairphone 6 fait mieux que son prédécesseur, avec 4 415 mAh, contre 4 200 mAh sur le Fairphone 5. Force de ces smartphones, la batterie peut se changer soi-même via sept vis amovibles. L’autonomie estimée en usage courant est de 53 heures, avec une recharge acceptant 30 W et permettant de remonter à 50 % en 20 min. Attention cependant, le chargeur n’est pas fourni, comme souvent maintenant.
Le Fairphone 6 affiche des dimensions de 156,5 x 73,3 x 9,6 mm pour un poids de 193 g.
Logiciel, durabilité et prix
Le Fairphone 6 est accompagné d’Android 15 en version stock, donc sans surcouche et applications tierces. Il n’y a surtout qu’une modification : Fairphone Moments. Il s’agit d’un mode spécifique que l’on peut activer pour entrer en « détox numérique ». Via un bouton sur la tranche de l’appareil, on le fait basculer dans une interface minimaliste ne permettant que d’accéder aux fonctions de base : téléphone, messages, appareil photo, musique et notes. On peut affecter une application spécifique à chaque catégorie et créer des profils pour modifier leur fonctionnement selon le contexte (soirée tranquille, concentration, voyage, etc.).
La durabilité de l’appareil s’exprime de plusieurs manières. Le Fairphone 6 peut fièrement afficher la note maximale sur la nouvelle étiquette énergie en Europe : A. Il l’obtient aussi dans deux autres catégories : résistance aux chocs et réparabilité. Rappelons que pour obtenir A en résistance aux chocs, il faut que l’appareil reste parfaitement fonctionnel après avoir résisté à au moins 270 chutes d’une hauteur d’un mètre.
Pour le reste, l’appareil résiste à un minimum de 1 000 cycles de charge tout en préservant un état d’au moins 80 %, et il affiche une garantie IP55. Celle-ci, représentant la résistance aux poussières et à l’eau (Le Fairphone 6 n’est ainsi protégé que contre des jets d’eau, pas une immersion), est clairement en dessous de ce que l’on peut trouver sur des iPhone et Pixel, certifiés pour la plupart IP68. C’est le prix à payer pour la modularité de l’appareil, puisque le boitier n’est pas scellé. Fairphone affirme que la part de matériaux recyclés dépasse les 50 %.
Autre dimension importante de la durabilité : l’entretien logiciel. Le Fairphone 6 frappe fort, car il garantit huit ans de mises à jour d’Android, dont sept évolutions majeures. Il fait donc mieux sur le papier que les derniers Pixel de Google ou Galaxy S de Samsung, fournis avec sept ans de mises à jour. Le Fairphone 6 est donc très largement dans les clés du nouveau règlement européen dans ce domaine, qui réclame un minimum de cinq ans.
Le nouveau Fairphone ne s’encombre pas de détails : il n’est disponible qu’en une seule version, avec ses 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Le prix est de 599 euros et on peut le choisir en trois couleurs : Cloud White, Forest Green et Horizon Black, toutes avec une finition mate. Le téléphone est déjà disponible et sa livraison est annoncée comme prenant entre 2 et 5 jours.
Murena, qui propose des variantes maison du Fairphone avec son système /e/OS, vend déjà un Fairphone 6 adapté par ses soins sur son site. Le prix est de 649 euros.