Sanctions américaines contre la Russie: "Un symbole fort", pour Valérie Hayer


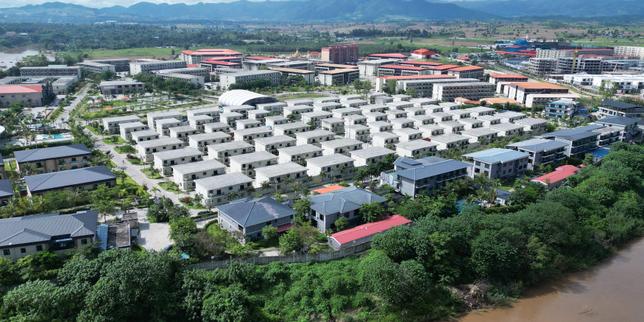
© LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP


© Patrick Pleul / AP
© Tatiana Meel / REUTERS

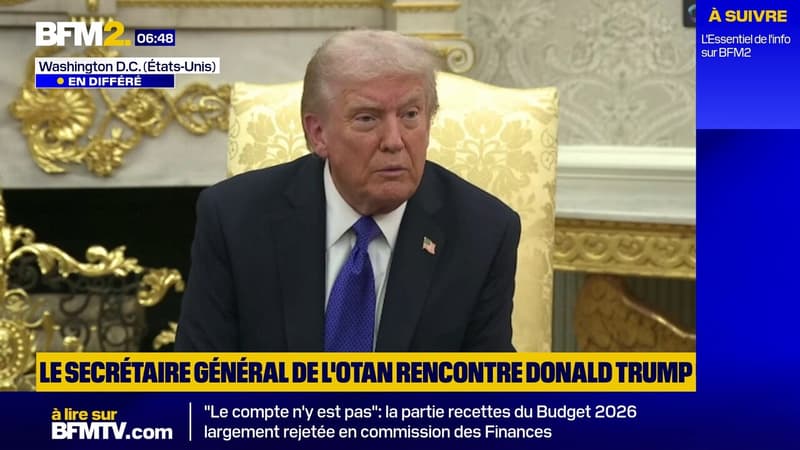

© Service d’urgence ukrainien via REUTERS


© Garett Jones
© Kevin Lamarque / REUTERS

"Je quitte cette réunion, lance un Donald Trump courroucé, je n’ai aucune raison de rester". La phrase du président américain fige tous les chefs d’Etat et de gouvernement réunis autour de lui, au sommet de l’Alliance atlantique le 12 juillet 2018 à Bruxelles. Le secrétaire général de l’Otan croit assister en direct à la fin de son organisation, qui garantit depuis plus de sept décennies la sécurité de l’Europe ; il cherche désespérément un moyen de faire revenir Trump sur sa décision de partir. Les mémoires des hommes politiques sont souvent fastidieux à lire mais ceux de Jens Stoltenberg font exception. Le récit que le Norvégien livre de son mandat à la tête de l’Otan, de 2014 à 2024, est vif, haut en couleur et surtout instructif (Vigie du monde, à la tête de l’Otan en temps de guerre, Flammarion, 496 pages, 24,90 €).
Des trois présidents américains qu’il a côtoyés pendant ces dix années (Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden) l’hôte actuel de la Maison-Blanche l’a le plus marqué. Soigner l’ego surdimensionné de l’Américain a occupé le Norvégien pendant des semaines entières. Son compte rendu du sommet de 2018 montre combien la survie de l’Otan tenait alors à un fil. Stoltenberg restitue sans filtre le coup de colère de Trump, qui reprochait à l’Allemagne de ne pas payer assez pour sa défense. "J’ai parcouru la salle du regard, écrit l’auteur. Tous étaient en état d’alerte maximale, certains appuyaient plus fort sur leur oreillette pour mieux entendre, d’autres, plus proches de Trump, l’avaient retirée pour entendre directement ses propos […]. Ce sommet pourrait bien marquer la fin de l’Otan".
Stoltenberg montre bien à quel point Trump est insensible aux tourments des Européens, qui comptent avant tout sur Washington pour leur sécurité. "Les Etats-Unis n’ont pas besoin de l’Otan, explique le président américain à ses homologues ce jour-là. Pourquoi devrais-je continuer à payer pour cette organisation si je n’en ai pas besoin ?" Et s’adressant directement à Angela Merkel, la chancelière allemande, il lance : "Angela, toi, tu peux payer les 2 % (NDLR : du produit intérieur brut) dès maintenant ! J’ai vu ton budget, tu as un excédent. Moi, j’emprunte pour assurer la défense, y compris celle de l’Allemagne, pendant que toi, tu fais des économies en comptant sur moi pour te protéger".
Selon le récit de Stoltenberg, c’est le Premier ministre néerlandais Mark Rutte (devenu depuis l’an dernier le successeur du Norvégien à l’Otan) qui sauve la mise des Européens ce jour-là. Rutte prend la parole pour souligner que les alliés des Américains avaient dépensé collectivement 33 milliards de dollars de plus l’année précédente pour leur défense. Il prend soin d’expliquer à l’adresse de Trump que cette hausse est la conséquence "de ton leadership". Quelques instants plus tard, en conférence de presse, Trump affirme aux journalistes : "Les Alliés dépenseront 33 milliards de plus, qui s’ajouteront aux engagements pris antérieurement". En réalité, aucun nouvel engagement n’avait été pris par quiconque lors du sommet. Mais pour Stoltenberg, l’essentiel était atteint : "Nous avions réussi à gagner du temps".
Les pages que Stoltenberg consacre aux préparatifs par la Russie de l’invasion de l’Ukraine en 2022, et à la guerre qui fait rage depuis, sont éclairantes. Il justifie le refus de l’Otan d’imposer une zone d’exclusion aérienne aux avions russes au-dessus de l’Ukraine, réclamée dès l’invasion par Volodymyr Zelensky, par le souci d’éviter que le conflit dégénère en troisième guerre mondiale. "Nous soutenions les Ukrainiens, mais nous n’étions pas prêts à mourir pour eux", résume le Norvégien. Il révèle qu’il a tenté de convaincre Volodymyr Zelensky d’accepter de renoncer à une partie des territoires occupés par la Russie en échange de la paix, sur le modèle de ce que la Finlande avait accepté après la guerre de 1939-1940 contre l’URSS. "Les Finlandais avaient dû céder 10 % de leur territoire et leur deuxième plus grande ville, Vyborg, à l’Union soviétique. Mais la Finlande avait survécu en tant qu’Etat indépendant".
Pour lui, l’essentiel est que l’Ukraine, elle aussi, survive comme Etat indépendant et démocratique, "avec des frontières sûres et une puissance militaire lui permettant de se défendre et d’avoir une force de dissuasion crédible contre de nouvelles attaques dans le futur". Et à ses yeux, une chose ne fait pas de doute : l’Ukraine "doit devenir membre de l’Union européenne et de l’Otan". "Si la guerre se terminait ainsi, ce serait une défaite pour Vladimir Poutine, même s’il continuait de contrôler la Crimée et le Donbass. Et une grande victoire pour l’Ukraine". Pas sûr que les Ukrainiens voient les choses de la même façon.

© AFP

© BRENDAN SMIALOWSKI / AFP


© JIM WATSON / AFP
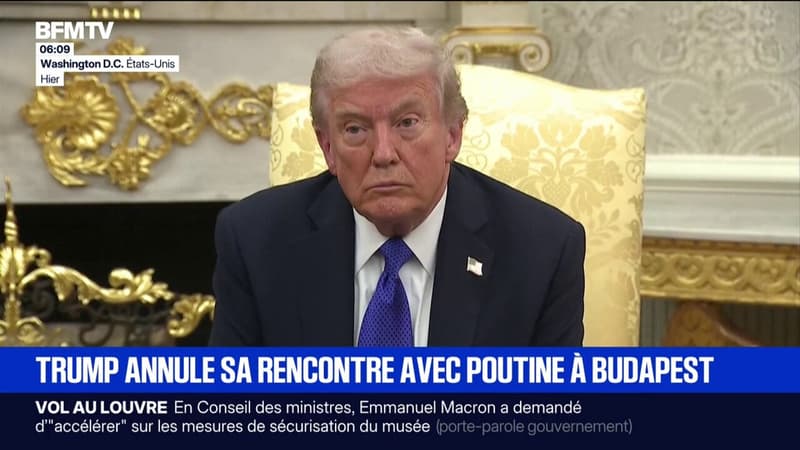

© Stephane Mahe / REUTERS
Plus de trois ans et demi après le début de la guerre, le scénario d’une paix en Ukraine - si chère à Donald Trump et sa quête du Prix Nobel - semble encore bien hypothétique. Mardi, Washington a fait savoir que la rencontre prévue à Budapest entre le président américain et son homologue russe n’aurait pas lieu dans "un avenir proche". Alors que sur le front la bataille continue de faire rage et les frappes russes de pleuvoir sur les villes ukrainiennes, L’Express s’est entretenu avec Yehor Cherniev, député ukrainien et vice-président de la commission de la sécurité nationale, de la défense et du renseignement à la Rada, pour faire le point sur les récents développements diplomatiques et militaires.
Le sommet entre Trump et Poutine est reporté sine die. Aura-t-il lieu ?
Yehor Cherniev : Je pense que Donald Trump a compris que Poutine cherche à gagner du temps, mais il voulait lui donner une dernière chance de montrer qu’il est prêt à mettre fin à cette guerre. Toutefois, si le président russe refuse d’avancer vers la paix en proposant des mesures concrètes, cela pourrait se retourner contre lui et ouvrir la voie à une livraison de Tomahawk à l’Ukraine et à de nouvelles pressions sur l’économie russe. Et cela me semble être le chemin à suivre. Parce qu’il est clair que Poutine veut seulement poursuivre la guerre. Rien n’indique un quelconque intérêt de sa part pour la paix. Cependant, avec nos partenaires, nous pouvons l’y forcer. En détruisant l’économie russe, par des sanctions et des frappes en profondeur.
Les États-Unis n’ont pas livré de missiles Tomahawk à l’Ukraine à l’issue de la rencontre Trump-Zelensky à Washington, le 17 octobre. Pour quelle raison ?
C’est une bonne question - même si la réponse appartient sans doute davantage à Donald Trump. Toutefois, on ne peut pas dire que la question des Tomahawk n’est plus à l’ordre du jour. En réalité, elle l’est toujours, mais elle est suspendue à une éventuelle rencontre entre le président américain et Vladimir Poutine. A mon sens, la question de la livraison des missiles Tomahawk à l’Ukraine constitue avant tout un moyen de pression sur Poutine. S’il accepte de faire marche arrière et de mettre fin à la guerre, alors les missiles Tomahawk ne seront probablement pas livrés. En revanche, s’il refuse, je pense que Trump sera, à terme, prêt à franchir le pas.
Mais la non-livraison des Tomahawk est un coup dur pour l’Ukraine…
Je reconnais qu’il serait formidable de disposer d’une nouvelle arme pour faire pression sur la Russie, avec des frappes en profondeur sur ses infrastructures critiques et sa production militaire. Pour l’instant, nous nous contenterons de continuer à le faire avec nos propres missiles et drones. Nous disposons de nos propres armes pour atteindre cet objectif, à l’instar de nos nouveaux missiles de croisière Flamingo, qui ont déjà porté des coups sévères à l’économie russe en détruisant des raffineries. Il s’agit de notre premier missile de croisière à longue portée et nous prévoyons de faire rapidement monter la production avec l’aide de nos partenaires.
L’Ukraine accepterait-elle vraiment de céder le Donbass aux Russes comme l’aurait, selon la presse américaine, suggéré Donald Trump ?
Non, même si le président Trump a contredit cette affirmation et indiqué avoir seulement mentionné les territoires déjà occupés par les Russes. Quoi qu’il en soit, la cession du Donbass n’est pas une option pour nous. Nous ne trahirons pas notre peuple qui vit encore là-bas. Et nous n’abandonnerons pas un territoire que la Russie n’a toujours pas réussi à conquérir depuis plus de douze ans - car c’est précisément dans le Donbass qu’a commencé la guerre en 2014. L’Ukraine refusera donc catégoriquement une telle option.
Selon Volodymyr Zelensky, la pénurie d’essence en Russie atteindrait 20 % des besoins russes. La campagne de frappes ukrainiennes fonctionne-t-elle mieux que les sanctions économiques ?
Je ne sais pas si cela fonctionne mieux, mais il est certain que cela ajoute une pression sur les infrastructures énergétiques russes. Et c’est l’un de leurs grands points faibles. Lorsque nous détruisons les raffineries russes, cela pèse lourdement sur leur secteur pétrolier. Ils ont ainsi récemment arrêté d’exporter de l’essence. De plus, les Russes se retrouvent avec un surplus de pétrole brut – ce qui fait baisser les recettes qu’en tire l’Etat russe. Détruire la source de financement la plus rentable de leur budget me semble être une bonne décision.
Les sanctions sont-elles efficaces ?
Je pense que détruire les raffineries fonctionne simplement plus rapidement que les sanctions, qui, une fois qu’elles sont décidées, prennent un certain temps avant d’avoir des effets. Il s’agit davantage d’un poison lent. De plus, les Russes ont eu le temps de s’y préparer, comme le montre l’exemple de leur flotte fantôme. Nous allons donc continuer à détruire leurs différentes installations - même si bien sûr cela restera des cibles d’intérêt militaire. Le but de cette campagne est de mettre un terme à ce conflit en détruisant leur capacité à poursuivre la guerre. Cela implique de détruire leur base industrielle de défense et leurs raffineries – qui alimentent l’une comme l’autre les besoins de leur armée sur le front.
Avec toutes les nouvelles armes qu’elle développe, l’industrie de défense ukrainienne est-elle en train de devenir l’une des plus puissantes d’Europe ?
Si l’on parle en termes de quantités produites, et de certaines technologies nouvelles comme les drones, la réponse est oui. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de couvrir tout le spectre de l’armement. Nous n’avons par exemple toujours pas notre propre système de défense antiaérienne, notre propre avion de combat ou nos propres navires de guerre. Parce qu’il s’agit d’armes très sophistiquées qu’il serait particulièrement long et complexe à développer. C’est précisément la raison pour laquelle nous proposons à nos partenaires des coopérations industrielles : afin d’échanger des technologies de part et d’autre. Nous pouvons vous faire bénéficier de notre expertise et de nos technologies dans les drones, et vous pouvez partager avec nous des technologies plus sophistiquées comme les défenses antiaériennes.
Récemment, de nombreux pays européens ont été victimes de survols de leurs territoires par des appareils russes. Qu’est-ce que les Européens peuvent apprendre de l’Ukraine dans la protection de leur ciel ?
Tout d’abord, nous sommes prêts à vous fournir notre expérience et certaines des solutions que nous utilisons. Par exemple, nous avons développé des drones dont la mission est d’en intercepter d’autres, comme les Shahed. La Pologne, qui a été survolée par une vingtaine de drones le mois dernier, s’est déjà positionnée pour en acquérir. Nous pouvons également vous expliquer ce que nous utilisons et comment nous l’utilisons. Typiquement, pour détruire les drones Shahed que Moscou produit en masse, nous essayons de ne pas utiliser de munitions trop coûteuses. Parce que cela viderait nos réserves et serait extrêmement onéreux. Nous privilégions donc les missiles air-air tirés depuis des avions, les drones intercepteurs, ou les hélicoptères.
Les Européens pourraient s’accorder jeudi sur une utilisation des avoirs gelés russes au profit de l’Ukraine. Comment pourraient être utilisées ces ressources ?
Cela ouvrira une nouvelle source de financement pour cette guerre. Et nous en avons besoin car il est très difficile de la poursuivre au même niveau que les années précédentes sans les dons de matériel militaire américain. Nous ne disposons malheureusement pas de ressources suffisantes pour financer la guerre et acheter des armes, car nos partenaires européens ne peuvent pas couvrir tous nos besoins sur le champ de bataille. Donc je pense qu’il est juste d’utiliser l’argent russe contre la Russie, et pas seulement le nôtre ou celui de nos alliés.
Quelle est votre évaluation de la situation sur le front ?
La situation est assez difficile, toutefois notre ligne de front est encore loin de s’effondrer. Les Russes poussent dans notre direction, mais nous parvenons également à reprendre quelques territoires. La situation est dynamique, mais il n’y a pas de percées. Les Russes utilisent des masses de soldats sans se soucier des pertes. De temps en temps, ils ont un succès qui consiste à pénétrer dans notre ligne de front avec un petit groupe de soldats, mais nous les retrouvons et les neutralisons rapidement.
La saison de chauffe va bientôt commencer en Ukraine. Vous attendez-vous à une intensification des frappes russes contre vos infrastructures énergétiques ?
Il est difficile d’être complètement prêt face à cela. Nous nous sommes préparés ces derniers mois et avons l’expérience des dernières années. Mais la Russie va continuer à frapper nos infrastructures énergétiques et essayer de provoquer des black-out dans nos villes. Et c’est pour cela que nous demandons plus de défenses antiaériennes à nos partenaires, et de l’aide pour réparer certains dommages causés à nos installations.

© afp.com/Alexander KAZAKOV

© Solène Reveney / « Le Monde »

© Nathan Howard / AP