Comment le camp de réfugiés palestiniens de Balata a échappé à la destruction

© Laurence Geai /MYOP pour « Le Monde »

© Laurence Geai /MYOP pour « Le Monde »

© Julia Demaree Nikhinson/AP
Au début des années 1980, Jean-François Revel a publié un livre qui s’appelait Comment les démocraties finissent. Les Etats-Unis venaient de perdre la guerre du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Ils avaient, sous Carter, été humiliés comme rarement dans leur histoire par le drame des 52 diplomates retenus en otages 400 jours en Iran par les Gardiens de la Révolution. L’URSS avait envahi l’Afghanistan et les régimes marxistes se multipliaient : Ethiopie, Nicaragua, Angola, Mozambique, Bénin, Congo-Brazzaville… Les pays communistes de longue date, Chine, Corée du Nord, Cuba et toute l’Europe de l’Est ne montraient aucun signe de faiblesse. Six ans plus tard le mur de Berlin tombait, l’URSS disparaissait, l’est de l’Europe retrouvait la liberté et Fukuyama publiait son livre La Fin de l’histoire qui proclamait le triomphe de la démocratie libérale. Aujourd’hui l’histoire semble avoir de nouveau changé d’avis et nous oblige à nous poser la question : Est-ce que Revel s’était trompé ou est-ce qu’il n’avait pas eu raison trop tôt ?
Le XXIe siècle n’a que 25 ans et déjà se dessinent ses enjeux majeurs, tous marqués par l’accélération de l’histoire. Accélération du changement climatique, qui menace l’humanité. Accélération des technologies et de l’intelligence artificielle avec ses espoirs formidables mais aussi ses risques, y compris sur la nature même de l’Homme. Accélération des bascules économiques et politiques avec la fin du bref moment unipolaire de l’Amérique, l’émergence de puissances régionales. Et bien sûr l’ascension de la Chine qui installe une nouvelle bipolarité en surplomb de ce monde multipolaire.
L’internationale des dictateurs s’est reformée. Plus d’idéologie, plus de doctrine, rien que les rapports de force. On a beau réinstaller les bustes de Staline en Russie, le communisme a fait place à une dictature mafieuse nationaliste et impérialiste. La Chine marie le capitalisme le plus sauvage à la surveillance implacable d’un régime totalitaire. La Corée du Nord est une tyrannie héréditaire et l’Iran une mollarchie maintenue par un effroyable appareil de répression.
Un seul but les unit : détruire l’ordre mondial instauré par les Etats-Unis et leurs alliés après 1945. Le mouvement des non-alignés des années 1950 sert de modèle à de nouvelles configurations. Les Brics, malgré leur absence d’unité, le Sud global dont le profil exact est inconnu, l’organisation de coopération de Shanghai sont surtout l’occasion de grands-messes. Mais elles donnent le ton et jouent sur le ressentiment contre la colonisation. Ressentiment assez curieux d’ailleurs puisqu’il épargne la Russie, pourtant le dernier empire colonial.
La guerre en Ukraine s’accompagne de toute la panoplie des provocations en Europe. Drones, flotte fantôme, sabotages, cyberattaques, campagnes de désinformation, influenceurs rémunérés, étoiles de David, mains rouges, têtes de cochon, faux sites Web, fermes à trolls… Une agression militaire contre l’Europe, donc contre l’Otan, n’est bien sûr pas à l’ordre du jour de la part d’un pays incapable de l’emporter contre un voisin trois fois moins peuplé. Mais nous sommes confrontés à trois types d’agressions simultanés. Guerre chaude en Ukraine et en Afrique, guerre froide pour l’heure en mer de Chine et dans le Pacifique, guerre hybride partout ailleurs. Ce qui est étonnant, c’est qu’alors que Poutine, Xi, Kim Jong-un et Khamenei déclarent ouvertement qu’ils veulent notre défaite et le changement de l’ordre du monde, les dirigeants des démocraties font tout pour regarder ailleurs. Combien de fois ces dernières années n’avons-nous pas entendu : "Nous ne sommes en guerre avec personne, nous ne voulons la guerre avec personne."
Cette forme d’aveuglement face aux guerres hybrides, je voudrais en donner un exemple. En 2018 j’ai réclamé dans une intervention au Sénat l’interdiction de Russia Today et de Sputnik, faux médias et vrais organes de désinformation du FSB pilotés depuis Moscou. Le ministre d’alors m’a répondu : "Vous n’y pensez pas, et la liberté d’expression". Le 25 février 2022 RT et Sputnik étaient interdits en urgence dans toute l’Europe. Il avait fallu l’invasion de l’Ukraine pour que l’on commence à comprendre que la cyberguerre c’est aussi la guerre. Et que ça n’a rien à voir avec la liberté d’expression.
Dans cette guerre hybride, nous n’avons pas que des ennemis extérieurs, nous avons aussi les cinquièmes colonnes. En Chine, en Russie ou en Iran, pas d’opposition. Ici, c’est ce qui fait à la fois la grandeur et la faiblesse des démocraties, l’extrême droite et l’extrême gauche peuvent passer leur temps à dire que Poutine est un grand dirigeant, que Zelensky est un despote, que la Chine n’est pas une dictature, que l’Ukraine n’existe pas, qu’elle a toujours été russe, que ses dirigeants sont des nazis… Cette cinquième colonne est aux portes du pouvoir, nous disent les sondages, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France. Lorsque aux Etats-Unis se multiplient les interventions de l’armée dans les grandes villes tenues par l’opposition, lorsqu’un président piétine la Constitution, multiplie les décrets illégaux, révoque les juges qui pourraient l’en empêcher, limoge d’un coup tout l’état-major militaire et prend le contrôle des réseaux sociaux, les populistes, dans une alliance improbable avec les dirigeants des Gafam, entreprennent la confiscation de la démocratie.
Mais le principal danger pour les démocraties ne vient ni des ennemis extérieurs, ni des cinquièmes colonnes. Le principal danger c’est celui qu’avait très bien expliqué Tocqueville, et il est inhérent au système démocratique. La démocratie est une promesse toujours inachevée. Au fur et à mesure que progressent les libertés, le bien-être et les conquêtes sociales, les inégalités qui subsistent, même minimes, deviennent insupportables. Si chacun est libre de s’accomplir, chacun peut se comparer, et donc être frustré. C’est donc une société qui produit de la déception et la fatigue d’être en permanence responsable de son destin.
S’y ajoute désormais la formidable accélération des réseaux que j’appelle "asociaux". Alors que les sociétés humaines ont toujours eu un besoin vital de valeurs communes, et la démocratie encore plus car elle promeut l’individualisme, les créateurs de ces réseaux ont très vite compris que ce qui créait le plus de buzz, donc le plus d’abonnés, donc le plus de pub, donc le plus de profit, était le contraire des idéaux démocratiques : l’émotion contre la raison, l’injure au lieu de la courtoisie, la menace au lieu du respect.
Je voudrais terminer par quelques bonnes nouvelles. La première est que les dictatures vont mal. La Russie est en train de se suicider. Aucun de ses buts de guerre n’a été atteint. Des centaines de milliers de morts, 700 000 déserteurs qui ont quitté le pays aggravant une démographie en chute libre. Des taux d’intérêt à 20 % qui empêchent tout investissement. Des réserves de devises et d’or presque épuisées. Mais le plus frappant c’est la dégradation totale de son influence. Poutine souhaitait la mort de l’Otan, il a réussi à la renforcer par l’adhésion de la Suède et de la Finlande. Il ne joue plus aucun rôle au Moyen-Orient. Ni en Syrie ni dans le conflit israélo-palestinien. Il n’est même plus en mesure d’arbitrer à ses frontières, entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan par exemple, où Trump a imposé un cessez-le-feu. Les autres voisins, Kazakhstan, Ouzbékistan, ont pris ostensiblement leurs distances depuis l’invasion de l’Ukraine. Lorsque la guerre s’arrêtera, et Poutine ne la gagnera pas, le bilan sera un désastre auquel il faudra sans doute ajouter la vassalisation par la Chine.
L’Iran vient de subir un camouflet historique. Ses proxys au Moyen-Orient ont été détruits par Israël. Les bombes américaines ont retardé une fois de plus l’échéance de l’arme nucléaire. Les sanctions sont remises en place. Les mollahs règnent par la terreur sur un peuple très majoritairement hostile au régime où les femmes sont à l’avant-garde de la contestation.
La Chine se porte beaucoup mieux évidemment. Et les Américains ont compris bien avant nous qu’elle serait le défi du XXIe siècle. Mais les prédictions sur le rattrapage et même le dépassement des Etats-Unis sont en train de s’effondrer. La gestion désastreuse du Covid, la crise immobilière qui n’en finit pas, la croissance qui chute, l’hostilité croissante des pays voisins contre le contrôle de la mer de Chine et surtout une crise démographique qui remet en question toutes les prévisions de croissance à moyen terme, assombrissent considérablement le bilan de Xi. Sans parler de ses menaces sur Taïwan auxquelles il devrait réfléchir en observant les résultats de l’invasion de l’Ukraine.
Que faire, comme disait Lénine, dans ce monde où tout a toujours très mal marché ? Le premier conseil que je pourrais nous donner c’est celui de Jean-Paul II en 1978 : N’ayez pas peur. Malgré les braillements de Medvedev, il n’y aura pas de guerre nucléaire. Pour mille raisons, mais notamment parce que les Chinois l’ont interdit à Poutine et qu’ils ne changeront pas d’avis.
Ensuite, dans ce monde où l’on cherche à faire croire à chacun qu’il est une victime, ne participons pas à la plainte générale. Mon grand-père a passé huit mois dans les tranchées à Verdun. Mes parents ont eu 20 ans en 1940 quand Hitler a envahi la France. Comment pourrions-nous oser nous plaindre, nous dont la génération n’a connu aucune guerre dans son pays depuis sa naissance et qui avons gagné 20 ans d’espérance de vie en 60 ans ?
Et enfin un conseil pour l’Europe, en panne de croissance, en panne de décision, en panne d’innovation ? Il est simple et le travail a déjà été fait par les plus compétents. Il s’appelle le rapport Draghi sur l’Europe-puissance. C’est la meilleure feuille de route qu’on ait tracée depuis longtemps et il fait l’unanimité. Mais au bout d’un an moins de 10 % de ses prescriptions sont appliquées. Le reste du monde n’attendra pas la lenteur de nos rituels communautaires. Il y a urgence.
Les démocraties sont-elles en danger ? La réponse est oui et elles l’ont toujours été. Est-ce qu’elles vont changer ? Très certainement. Est-ce qu’elles vont périr ? Je ne le crois pas une seconde. Mais cela dépend de nous. Et ça n’a pas changé depuis vingt-cinq siècles quand Périclès disait aux Athéniens : "Vous devez combattre pour vos lois comme pour vos murailles". Hölderlin disait, lui : " Il y a tout à défendre, il faut être fidèle". Soyons fidèles à nos lois, soyons fidèles à la démocratie.

© STEPHANE DE SAKUTIN/AFP
Après avoir réussi à obtenir une trêve à Gaza, déjà mise toutefois à rude épreuve, Donald Trump cherche désormais à en faire de même en Ukraine. Vendredi, il a reçu une nouvelle fois à la Maison-Blanche Volodymyr Zelensky et l’a pressé de cesser les hostilités, tout en restant sourd à ses demandes de soutien militaire renforcé. Il a en parallèle relancé le dialogue avec Vladimir Poutine, les deux dirigeants ayant convenu de se rencontrer prochainement à Budapest. Ce lundi 20 octobre, Volodymyr Zelensky s’est dit prêt à participer à ce sommet s’il y était invité. La veille, le président ukrainien a appelé Donald Trump à durcir le ton face au maître du Kremlin, assurant que son homologue russe était "plus fort que le Hamas", dans une interview à la chaîne de télévision NBC. Volodymyr Zelensky a également exhorté dimanche ses alliés à renoncer à toute politique d’apaisement envers la Russie : "L’Ukraine ne concédera jamais aux terroristes aucune récompense pour leurs crimes, et nous comptons sur nos partenaires pour maintenir cette position", a-t-il écrit sur Telegram.
Les infos à retenir
⇒ Les 27 approuvent l'interdiction d'importer du gaz russe d'ici 2027
⇒ Volodymyr Zelensky assure être prêt à se joindre à Donald Trump et Vladimir Poutine en Hongrie
⇒ L’Ukraine a "besoin" de 25 nouveaux systèmes antiaériens américains Patriot
L'interdiction d'importer du gaz naturel russe dans l'Union européenne d'ici fin 2027 a été approuvée ce lundi par la majorité des Etats membres, lors d'une réunion des ministres européens de l'Energie à Luxembourg.
Cette mesure, qui doit maintenant être négociée avec le Parlement européen, avait été proposée au printemps par la Commission européenne. En cessant ses achats de gaz naturel russe, l'UE veut assécher une source de financement majeure de la guerre menée par Moscou en Ukraine.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré être prêt à se joindre à la rencontre prévue prochainement à Budapest entre ses homologues américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, s’il recevait une invitation en ce sens.
Les deux dirigeants doivent se retrouver dans la capitale hongroise pour leur deuxième sommet destiné à trouver une issue à la guerre en Ukraine. "Si je suis invité à Budapest, s’il s’agit d’une invitation sous la forme d’une rencontre à trois, ou comme on l’appelle, d’une diplomatie itinérante, où le président Trump rencontre Poutine et où le président Trump me rencontre, alors, sous une forme ou une autre, nous nous mettrons d’accord", a déclaré Volodymyr Zelensky lors d’une conférence de presse.
Il a pour autant estimé que Budapest n’est pas "le meilleur lieu pour cette réunion". Proche allié de Donald Trump au sein de l’Union européenne, le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, est resté conciliant avec Vladimir Poutine malgré l’invasion de l’Ukraine et s’est montré au contraire très critique envers Volodymyr Zelensky.
Selon Volodymyr Zelensky, les conditions de la Russie pour aboutir à une paix demeurent inchangées, avec notamment le retrait des forces ukrainiennes de la totalité du Donbass, région industrielle de l’est de l’Ukraine que Moscou veut annexer. Il a précisé avoir expliqué à ses interlocuteurs américains lors de sa visite à Washington que "la position de l’Ukraine n’avait pas changé", c’est-à-dire qu’elle rejetait les conditions russes. "Nous n’allons pas donner la victoire aux Russes", a-t-il insisté.
Trois jours après sa visite à Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé ce lundi que son pays avait "besoin" de 25 systèmes antiaériens américains Patriot supplémentaires, une arme moderne et coûteuse, pour faire face aux frappes de missiles russes.
Il a affirmé lors d’une conférence de presse avoir "engagé des discussions avec des entreprises du secteur de la défense" afin "de préparer un contrat pour 25 systèmes Patriot". "Ce sont 25 systèmes dont nous avons besoin", a-t-il souligné. Les Etats-Unis ne fournissant plus à l’Ukraine que des armements payés par les Européens, l’argent pour ces Patriot devrait "provenir de l’utilisation des avoirs russes gelés", a plaidé Volodymyr Zelensky.
Vendredi, lors de sa visite à Washington, le président ukrainien n’est pas parvenu à convaincre Donald Trump de fournir à l’Ukraine des missiles de croisière américains Tomahawk. "À mon avis, il ne souhaite pas d’escalade avec les Russes avant de les avoir rencontrés" à Budapest, a jugé le président ukrainien.
Une attaque de drone a fait deux morts et un blessé dans la région russe de Belgorod, a annoncé tôt lundi le gouverneur de ce territoire frontalier de l’Ukraine. "Deux civils ont été tués dans le village de Yasnye Zori lorsqu’un drone a largué des explosifs sur une entreprise agricole", a rapporté Viatcheslav Gladkov sur le réseau social Telegram. Un autre civil a été blessé, a-t-il ajouté.
Depuis le début de son offensive il y a trois ans et demi, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l’Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe - et notamment des infrastructures énergétiques.
Vendredi, le président américain Donald Trump, qui affiche une complicité retrouvée avec le président russe Vladimir Poutine, a pressé Volodymyr Zelensky de cesser les hostilités, en restant sourd aux demandes de soutien militaire renforcé du numéro un ukrainien.

© dpa Picture-Alliance via AFP


© « Le Monde »
Une trêve fragile à Gaza. Après l’entrée en vigueur le 10 octobre d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans l’enclave palestinienne, l’espoir renaît au Proche-Orient. Mais les équilibres de la région demeurent plus que précaires : dimanche 19 octobre, l’armée de l’État hébreu a de nouveau lancé des frappes aériennes meurtrières sur la bande de Gaza, après avoir accusé le mouvement islamiste d’avoir lui-même rompu l’arrêt des combats. D’après la défense civile, qui agit sous l’autorité du Hamas, et des hôpitaux locaux, 45 personnes auraient été tuées dans ces bombardements.
Les infos à retenir
⇒ Israël annonce la réouverture du point de passage de Kerem Shalom avec Gaza
⇒ Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner en Israël
⇒ Le cessez-le-feu à Gaza est toujours en vigueur, selon Donald Trump
Le point de passage de Kerem Shalom, entre Israël et la bande de Gaza, a rouvert au lendemain d'une série de frappes israéliennes sur le territoire palestinien, a annoncé lundi un responsable de la sécurité israélien. Kerem Shalom a rouvert "en pleine conformité avec l'accord" de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, a déclaré ce responsable. Dimanche, Israël avait annoncé suspendre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza "jusqu'à nouvel ordre", accusant le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu, ce que le mouvement islamiste a nié.
A ce stade, la réouverture du poste-frontière de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Egypte, prévue dans le cadre du plan Trump, reste cependant en suspens malgré les appels des agences des Nations unies et d'autres acteurs majeurs comme la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge. Cet accès est hautement stratégique pour acheminer l'aide humanitaire, évacuer les blessés et reconstruire le territoire ravagé par deux ans de guerre entre Israël et le Hamas.
Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés lundi en Israël, a annoncé une porte-parole de l'ambassade américaine, en vue de discussions avec des responsables israéliens sur la situation à Gaza.
"Le message le plus important que nous avons essayé de transmettre aux dirigeants israéliens, maintenant que la guerre est terminée, c'est que si vous voulez intégrer Israël dans l'ensemble du Moyen-Orient vous devez trouver un moyen d'aider le peuple palestinien à prospérer et à faire mieux", a affirmé Jared Kushner, gendre du président Donald Trump, dimanche soir sur CBS News, lors d'un entretien, enregistré avant les frappes israéliennes qui ont frappé la bande de Gaza dimanche.
"C'est une situation très difficile et une dynamique très complexe", a admis Jared Kushner. "En ce moment, le Hamas fait exactement ce que l'on pourrait attendre d'une organisation terroriste, c'est-à-dire essayer de se reconstituer et de reprendre ses positions", a fait valoir l'émissaire. Mais si "une alternative viable" se dégage, "le Hamas échouera et Gaza ne constituera pas une menace pour Israël à l'avenir", a-t-il assuré.
Tandis que de nouvelles frappes israéliennes ont touché la bande de Gaza, le président américain a été questionné dimanche par des journalistes sur le maintien ou non du cessez-le-feu dans l’enclave. "Oui, il l’est toujours", a répondu Donald Trump, depuis Air Force One. Selon lui, les derniers événements ne remettent pas en cause la trêve, entrée en vigueur le 10 octobre dernier, après l’acceptation par Israël et le Hamas de la première phase de son plan de paix imaginé pour la région.
Le milliardaire républicain a évoqué l’action de "certains rebelles au sein du mouvement" qui seraient impliqués dans des violations présumées du cessez-le-feu par le Hamas. Toujours d’après ses propos, ses dirigeants pourraient ne pas être liés aux incidents rapportés par Israël, qui ont conduit l’État hébreu à reprendre ses frappes. "Quoi qu’il en soit, la situation sera gérée correctement", assure Donald Trump. "Elle sera gérée fermement, mais correctement." Le locataire de la Maison-Blanche a ajouté que Washington souhaitait avant tout s'"assurer que tout se passera dans le calme avec le Hamas".
Dimanche, l’armée israélienne a donc lancé une nouvelle série de frappes aériennes sur la bande de Gaza, en dépit d’un cessez-le-feu dans l’enclave. Selon la défense civile, qui opère sous l’autorité du Hamas, au moins 45 personnes auraient été tuées dans ces raids. Plusieurs civils et un journaliste feraient partie des victimes. L’AFP s’est fait confirmer ce bilan par quatre hôpitaux de Gaza.
Ces tirs marquent les premiers incidents d’ampleur dans le territoire, depuis l’entrée en vigueur d’une trêve entre Israël et le Hamas, il y a dix jours. L’État hébreu a justifié son offensive en évoquant des actes hostiles de la part du mouvement islamiste. D’après un responsable israélien, des troupes du pays auraient été visées à Rafah, tandis que des combattants palestiniens, qui se seraient approchés d’une zone de contrôle israélienne au nord de l’enclave, ont été "éliminés" lors d’une frappe. Dimanche soir, Israël a dit cesser ses tirs et reprendre l’application du cessez-le-feu.

© afp.com/Eyad BABA
Leur mésentente n’en finit plus. Le président américain Donald Trump et son homologue colombien Gustavo Petro se sont de nouveau livrés à une passe d’armes ces dernières heures. La raison ? Une nouvelle frappe américaine sur un navire en mer des Caraïbes, zone où Washington a entrepris depuis l’été dernier une vaste opération militaire contre les "narcoterroristes". Les États-Unis ont déjà ciblé plusieurs navires au large du Venezuela, mis en cause par le milliardaire républicain pour son rôle dans le trafic de drogue.
Dimanche 19 octobre, le ministre de la Défense Pete Hegseth a ainsi indiqué que les forces américaines avaient détruit en mer un bateau affilié au groupe paramilitaire colombien de l’Armée de libération nationale (ELN), tuant trois passagers. L’embarcation était en train d’acheminer de la drogue, a assuré le responsable. Avec cette nouvelle frappe, au moins 30 personnes sont mortes depuis août lors des opérations de l’US Army dans la région. Des missions qui suscitent la circonspection des experts juridiques, certains se questionnant sur la légalité de telles initiatives.
Le débat ne semble pas inquiéter Donald Trump, engagé dans un bras de fer avec le régime de Nicolás Maduro au Venezuela et bien décidé à imposer un rapport de force envers le pouvoir de Gustavo Petro. Dimanche, sur son réseau Truth Social, le président américain a qualifié le dirigeant colombien de "figure emblématique du trafic de drogue", qui "encourage fortement" la production de stupéfiants dans son pays. "Je respecte l’histoire, la culture et les peuples des États-Unis", a réagi dans la foulée sur X Gustavo Petro. "Ils ne sont pas mes ennemis. […] Le problème, c’est Trump, pas les États-Unis."
Plus tôt dans le week-end, le président colombien avait été bien plus loin dans ses griefs envers le locataire de la Maison-Blanche. Gustavo Petro avait accusé Donald Trump d’être coupable de meurtre, après une autre frappe américaine contre un bateau en mer, menée selon Bogota dans l’espace maritime colombien. "Le pêcheur Alejandro Carranza", qui aurait été tué lors de ce tir, "n’avait aucun lien avec le trafic de drogue et son activité quotidienne était la pêche", avait assuré le président sud-américain, toujours sur X.
Ces incriminations d’"assassinat", commis d’après Gustavo Petro en violation "des eaux territoriales" de son pays, ne font pas davantage sourciller les membres de l’administration Trump. Le vice-président américain, J.D. Vance, a juré dimanche "se ficher" de ce qu’allaient devenir les survivants des tirs américains – "tant qu’ils n’introduisent pas de poison dans notre pays", a-t-il précisé. De son côté, Gustavo Petro a encouragé la famille du pêcheur tué à porter plainte aux côtés des proches d’un autre homme, ressortissant de Trinité-et-Tobago, qui serait mort lui aussi lors d’une frappe américaine.
Avec tous ces événements, la montée en tension entre les deux pays, longtemps proches alliés, ne paraît pas près de s’arrêter. D’autant que Donald Trump vient d’invoquer son arme favorite pour faire plier la Colombie : les droits de douane. Bogota, jusque-là passé entre les gouttes de l’offensive douanière menée tambour battant par le président américain depuis le printemps dernier, était seulement soumise au taux universel de 10 % de surtaxe sur ses produits exportés aux États-Unis. Dimanche, interrogé par des journalistes à bord d’Air Force One, le républicain a promis d’augmenter ce tarif, sans préciser l’ampleur exacte de la mesure.
Pour la Colombie, important fournisseur de café et de pétrole aux États-Unis, le coût économique d’une telle sanction s’avérerait douloureux. En janvier dernier, juste après le retour de Donald Trump au pouvoir, le pays s’était déjà vu menacer de 25 % de droits de douane. Gustavo Petro refusait alors d’accueillir sur le sol colombien des avions de migrants de son pays expulsés par les États-Unis. Mais la détermination de Washington à imposer des surtaxes importantes l’avait finalement contraint à accepter les avions. "Le gouvernement colombien a accepté toutes les conditions du président Trump", s’était félicité à l’époque la Maison-Blanche, dans un communiqué.
La nouvelle stratégie américaine vis-à-vis de la Colombie marque en tout cas un tournant dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Dans la région, Bogota faisait ces dernières décennies office de partenaire solide pour les États-Unis. En 2023, lors d’une visite de Gustavo Petro dans la capitale américaine, l’ex-président Joe Biden avait qualifié l’État comme "clé" en Amérique du Sud. Aujourd’hui, Donald Trump le place désormais au même rang que d’autres nations comme la Bolivie, l’Afghanistan ou la Birmanie, qui ont selon lui "manifestement échoué" à assurer leurs engagements en matière de lutte contre les stupéfiants.
Sur ce point, il est vrai que la Colombie se situe à l’heure actuelle comme le premier producteur au monde de cocaïne. Un record de 2 600 tonnes fabriquées a été relevé en 2023 dans le pays, selon des chiffres de l’ONU. Les autorités colombiennes reçoivent de la part de Washington d’importants fonds pour tenter de lutter contre ce fléau, alimenté par les groupes armés locaux, pour qui ce trafic de stupéfiants constitue une manne conséquente pour financer leurs activités illégales.
En 2023, tous champs d’action compris, au-delà de cette question spécifique de la drogue, les États-Unis ont ainsi versé 740 millions de dollars d’aides à la Colombie. Tout en restant flou, Donald Trump a promis dimanche de revenir sur ce dispositif. "À partir d’aujourd’hui, ces paiements" et "subventions" ne "seront plus versés à la Colombie", a-t-il promis. Cet État d’Amérique latine, jusque-là le plus aidé du continent par le pouvoir américain, souffre aussi des coupes budgétaires drastiques opérées par l’administration républicaine au sein de l’Usaid, l’agence américaine pour le développement international.
Cette mise à distance américaine conduit Bogota à se tourner vers d’autres grandes puissances pour dynamiser son économie. En mai dernier, Gustavo Petro a conclu avec le président chinois Xi Jinping un "accord de coopération" pour construire ensemble "les nouvelles routes de la soie", projet phare de Pékin à l’échelle mondiale. De nombreuses autres nations sud-américaines ont signé avec la Chine des partenariats similaires dans ce cadre. "L’histoire de nos relations extérieures est en train de changer", notait ainsi Gustavo Petro, au moment de sa rencontre avec le dirigeant asiatique.

© afp.com/Joaquín Sarmiento, Mandel Ngan

Mettant fin à 20 ans de gouvernements socialistes, le sénateur de centre-droit Rodrigo Paz a remporté dimanche 19 octobre le second tour de la présidentielle en Bolivie avec 54,5 % des voix, selon le dépouillement de plus de 97 % des bulletins, a annoncé le Tribunal suprême électoral (TSE). Le président élu s’est félicité après sa victoire de voir le pays "peu à peu retrouver sa place sur la scène internationale". "Il faut ouvrir la Bolivie au monde et lui redonner un rôle", a-t-il lancé.
Dans un communiqué, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a félicité le vainqueur, saluant "une occasion de transformation", après "deux décennies de mauvaise gestion". Il a ajouté que les États-Unis étaient prêts à coopérer avec la Bolivie sur la sécurité régionale, les investissements et la lutte contre l’immigration illégale.
Rodrigo Paz accède au pouvoir dans un pays qui, sous Evo Morales (2006-2019), a poussé très loin le virage à gauche : nationalisation des ressources énergétiques, rupture avec Washington, alliances avec le Venezuela d’Hugo Chavez, Cuba, la Chine, la Russie ou encore l’Iran.
A l’annonce des résultats, les rues de La Paz se sont remplies de partisans du vainqueur, aux sons de pétards, de cris de joie et de musique. "Nous sommes venus célébrer la victoire avec beaucoup d’espoir de donner un nouveau cap à la Bolivie", a déclaré Julio Andrey, un avocat de 40 ans, estimant que l’économiste de 58 ans était "plus proche des revendications populaires" que son rival.
Héritier d’une influente dynastie politique, Rodrigo Paz est un modéré au ton populiste qui se présente comme un homme de consensus. Son adversaire de droite Jorge "Tuto" Quiroga a lui obtenu 45,4 % des suffrages. "J’ai appelé Rodrigo Paz Pereira pour le féliciter", a-t-il déclaré, reconnaissant sa défaite. Devant la presse, le populaire vice-président élu, Edmand Lara, a appelé "à l’unité et à la réconciliation entre les Boliviens".
Le président élu succédera le 8 novembre à l’impopulaire Luis Arce, qui a renoncé à se représenter et quittera le pouvoir au terme d’un mandat de cinq ans marqué par la pire crise économique que le pays ait connue en 40 ans.
La chute des exportations de gaz, due au manque d’investissements, a tari les réserves en dollars et rendu intenable la coûteuse politique de subvention des carburants. Faute de devises pour les importer, la pénurie d’essence et de diesel s’aggrave et les prix s’envolent.
L’inflation annuelle dépasse à présent 23 %, et les longues files de véhicules attendant un hypothétique réapprovisionnement des stations-service sont devenues banales dans ce pays presque deux fois plus grand que la France, mais avec 11,3 millions d’habitants.
Les deux candidats ont prôné des politiques similaires, fondées sur une forte réduction des dépenses publiques - notamment des subventions aux carburants - et une plus grande ouverture au secteur privé.
Rodrigo Paz a cependant défendu un "capitalisme pour tous" fondé sur la décentralisation et la rigueur budgétaire avant tout nouvel endettement. Son rival, plus radical, plaidait pour une ouverture totale aux marchés internationaux et le recours à de nouveaux crédits.
"Paz a gardé un ton très calme, très centriste", souligne la politologue Daniela Keseberg, interrogée par l’AFP. "Il connecte bien avec la population, on sent que les gens l’aiment […] il a touché ceux qui veulent un changement, mais pas un changement radical".
Il ne disposera pas d’une majorité au Parlement, ce qui va le contraindre à former des alliances. Arrivé en tête du premier tour en août, il dispose cependant du groupe parlementaire le plus important, avec 49 députés et 16 sénateurs, devant celui de Jorge Quiroga (39 et 12).
Le nouveau président élu devra également faire face à la vive opposition d’Evo Morales, toujours populaire parmi les Boliviens autochtones notamment et qui n’a pas pu se présenter en raison de la limite des mandats. "Morales reste un facteur de déstabilisation", avertit Daniela Osorio, politologue au German Institute of Global and Area Studies (GIGA).

© afp.com/AIZAR RALDES

© EYAD BABA / AFP


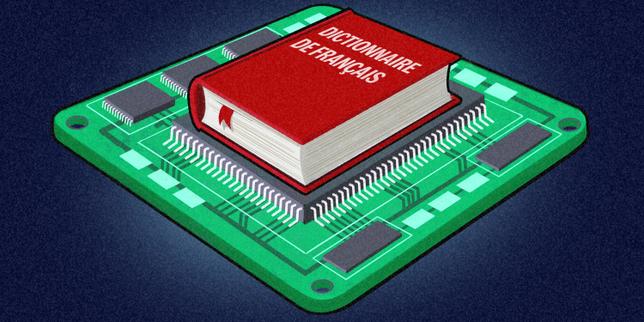
© LÉA GIRARDOT/« LE MONDE »

© Manuel Balce Ceneta / AP

© HECTOR RETAMAL / AFP

